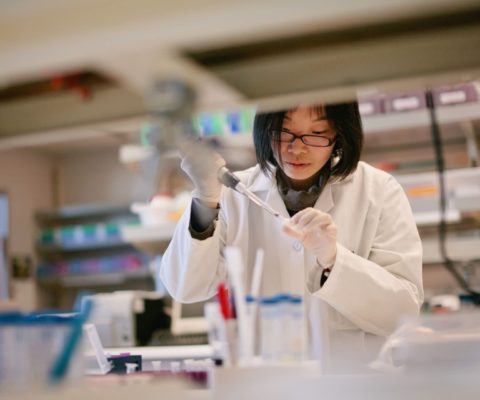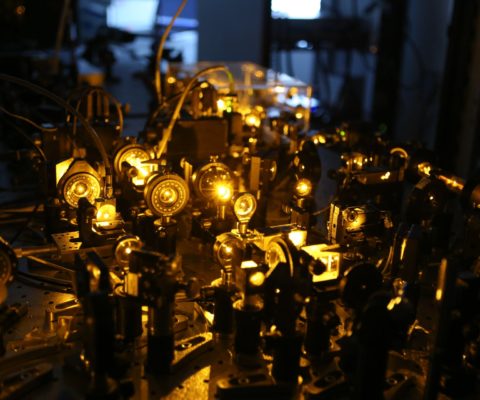Une science de la science pour nos sociétés de la connaissance
Pr Pierre-Michel Menger
Nous sommes, nous dit-on depuis au moins une vingtaine d’années, entrés dans la société de la connaissance. Quelle place y occupe la recherche scientifique et la R&D ? Assurément une place de premier plan, puisque, de la recherche à la découverte puis à l’invention et à l’innovation, il y a une chaîne évidente de causalité transformatrice, et que nul mieux que le travailleur du savoir ne sait ce qu’est le prix de la connaissance – ce qu’elle procure et ce qu’il en coûte de la produire. Les scientifiques sont dans cette situation originale d’être les premiers destinataires, et très souvent les seuls consommateurs de ce qu’ils produisent. Bien sûr, l’acte même de publier indique bien que la vocation de la connaissance produite par les sciences est d’être un bien public. Chacun peut en connaître le contenu sans gêner quiconque, puisque c’est un bien public non rival, au stade de la publication, mais non pas à celui de l’exploitation, lorsque la connaissance est une invention brevetable. La publication des travaux scientifiques sous forme d’articles est à l’origine même de l’essor de la science moderne, à partir du 17ème siècle. Derek de Solla Price, l’inventeur de ce qui s’appelle depuis les années 1960, la « science de la science », y a vu l’origine de la croissance exponentielle du nombre de chercheurs et de la quantité de publications depuis trois siècles.
Le front de la recherche, dans chaque discipline, peut être décrit comme un incessant processus d’absorption très sélective des connaissances jugées les plus utiles et importantes, et d’obsolescence plus ou moins rapide des connaissances sélectionnées, absorbées puis dépassées par le mouvement continuel de la recherche. Pour que les chercheurs agissent à la fois en producteurs, en évaluateurs et en consommateurs du bien public de connaissance, il faut que leur activité obéisse à quelques règles fondamentales : le libre examen critique et sceptique des résultats soumis à évaluation, le contrôle de la validité des données, de la rigueur des méthodes et de la justesse éthique des comportements dans l’exercice du travail de recherche, l’impartialité dans l’évaluation des travaux soumis, pour ne citer que les dimensions principales. Ces valeurs régulatrices sont d’autant plus importantes, mais aussi d’autant plus fragiles que les chercheurs sont en compétition entre eux pour produire les connaissances nouvelles, pour attirer l’attention sur leur travail, pour susciter les collaborations de recherche les plus fécondes, pour être crédités de la priorité dans la course aux découvertes, et pour obtenir les ressources matérielles et humaines indispensables à leur travail et à leurs ambitions. La compétition a en outre ceci d’original qu’elle repose sur l’abolition de tous les murs et de toutes les frontières – murs des institutions (laboratoires, universités), frontières des pays. La science est universaliste en un double sens : la valeur de ce qu’elle produit doit être indépendante des caractéristiques de celles et ceux qui la produisent, et elle a vocation à être diffusée aussi largement et rapidement que possible. Cet universalisme ne conduit pas les chercheurs et leurs institutions à souscrire à un projet de non rivalité perpétuelle entre les nations soucieuses de produire les découvertes et innovations de valeur. Certes, les coopérations internationales se sont multipliées autour de très grands projets et équipements, et les collaborations entre les chercheurs de pays différents se sont intensifiées, au point qu’on a pu mesurer l’évolution du travail scientifique à partir des distances kilométriques croissantes entre les partenaires d’un projet, distances certes abolies par les technologies innovantes de communication, mais pas de la même manière dans les différentes sciences.
Mais la compétition entre les nations et entre les grandes universités mondiales s’intensifie tout autant. La « guerre pour les talents » était une formule inventée, à la fin des années 1990, pour décrire et corriger les pratiques de débauchage qui concernaient les cadres dirigeants des entreprises. Elle s’est déployée vers les métiers de l’informatique, et elle s’est accélérée avec la révolution numérique. Un trafic des talents existe aujourd’hui dans les grandes aires métropolitaines d’innovation du monde, qu’accélèrent les transferts entre la recherche académique et les innovations de l’industrie et des services. Et une compétition de plus en plus ouverte est engagée entre les États-Unis, la Chine et, espérons-le, l’Europe, pour se situer sur le front le plus avancé de la recherche dans celles des sciences fondamentales qui sont jugées les plus stratégiques et pour créer les synergies les plus efficaces entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la production d’innovations en R&D. Le brain drain a pendant longtemps permis aux États-Unis d’accroître leur productivité scientifique et d’occuper une position dominante. La Chine s’efforce de faire revenir ceux et celles qu’elle appelle ses milliers de « talents scientifiques », dont elle avait sous-traité la formation aux grandes nations scientifiques occidentales pendant une quinzaine d’années.
La mobilisation de la recherche scientifique et de la recherche clinique provoquée par la pandémie actuelle modifie-t-elle ce paysage concurrentiel? Il est trop tôt pour connaître la part respective qu’occupent la coopération et la compétition dans la mobilisation mondiale des chercheurs et des industriels, aux divers stades du travail complexe que requièrent l’identification et l’analyse du virus, celles des déterminants de sa nocivité et de sa létalité différentielles, et la mise au point de traitements et d’un ou plusieurs vaccins efficaces. L’urgence de la découverte d’un vaccin a placé cette mobilisation sous une pression sans précédent. L’image de la science qui a émergé de la chronique quotidienne de la pandémie depuis les premiers mois de 2020 a fait apparaître, avec un relief saisissant, les forces et les fragilités de ces règles que j’évoquais plus haut, quand la recherche doit aller vite, et qu’elle doit aussi nourrir la décision publique en temps réel, dans l’urgence de l’action en horizon incertain, en s’exposant aux conflits d’expertise sur les multiples dimensions et temporalités des risques auxquels il faut faire face.
Prudence, scepticisme fonctionnel, travail par essais et erreurs, aveu d’ignorance, doute méthodique, critiques croisées, voilà tout ce qui fait l’ordinaire du travail de recherche, tel qu’il est pratiqué, discuté, et amendé dans la communauté des chercheurs. Il suffit que l’urgence fasse tomber les murs de la cité scientifique, quand les médias doivent alimenter le public en flux d’informations continues, pour que ces valeurs cardinales de la recherche risquent de se retourner contre elle. Les sceptiques, mais non savants ceux-là, trouveront dans le doute méthodique que pratiquent les chercheurs de quoi alimenter et diffuser les soupçons et la défiance. L’infox prospère sur ce qui devient une « infodémie », et, hélas, ceux des chercheurs qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas contrôler l’usage qui est fait de leurs annonces et déclarations risquent aisément de devenir les instruments de la déraison défiante. Il y a en effet une asymétrie profonde dans la réception des informations délivrées en temps continu : celles qui font état d’incertitudes et de tâtonnements sont plus aisées à convertir en infox que les avancées lentes des recherches ne sont aisées à convertir en preuves de scrupule nécessaire et salutaire. Heureusement, les découvertes (la mise au point de vaccins) rétablissent l’équilibre, mais sans jamais décourager le doute non méthodique.
Mais il y a ici plus que le paradoxe de l’excès d’informations et la feuilletonnisation des avancées en temps réel des recherches. Une crise telle que cette crise sanitaire, et bien d’autres dont l’actualité n’est pas avare (crise climatique des pollutions, tempêtes et réchauffements extrêmes, accidents nucléaires, affaires du sang contaminé ou du Mediator, suspicion d’espionnage ou de surveillance à grande échelle via les technologies de communication, incrimination des ondes téléphoniques, etc) font apparaître une grande constellation des facteurs impliqués. Cette multifactorialité agit directement pour transformer la contribution de chaque science particulière à l’explication de phénomènes complexes en une arène de compétition entre les expertises mobilisées. Chaque expertise revendique son « aire de juridiction » scientifique sur la compréhension et le traitement possible des risques concernés, et il n’y a pas de juge de paix souverainement sage pour régler le conflit des expertises, s’agissant de problèmes complexes. Car l’expertise est la mise en œuvre de connaissances à des fins de décision : face à des questions complexes, l’incertitude sur la contribution respective de facteurs multiples libère et augmente tout à la fois la coopération nécessaire et la compétition inévitable des expertises. Et dès que l’expertise est légitimement sollicitée par la puissance publique, les parties prenantes situées hors des domaines spécialisés de recherche sont plus nombreuses encore, pour agir dans l’arène des échanges, des confrontations et des controverses. Voilà ce que les travailleurs de la connaissance que sont les chercheurs, mais aussi tous les citoyens de nos « sociétés de la connaissance » doivent savoir, et que la science de la science peut aider à mieux comprendre, sans verser dans le constructivisme relativiste, ce poison lent qui veut abolir l’autonomie nécessaire du travail endurant et incertain des chercheurs pour les transformer en simples quidam manœuvriers.
Pr Pierre-Michel Menger
Chaire de Sociologie du travail créateur
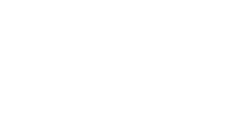
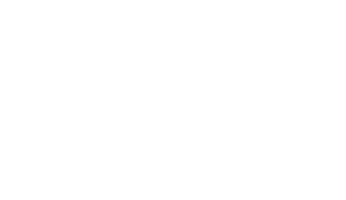












![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)
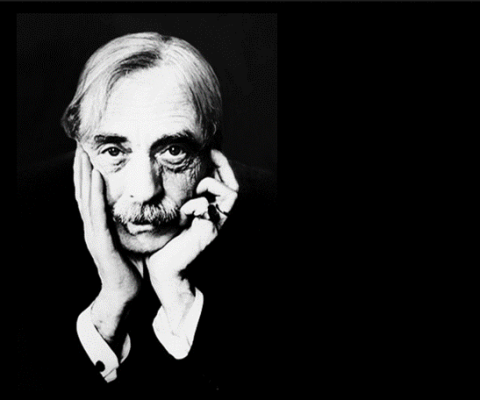


![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)



![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)




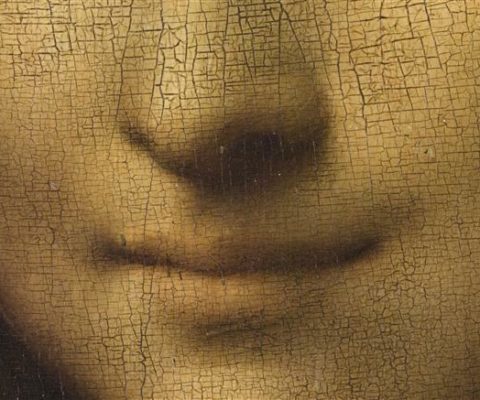

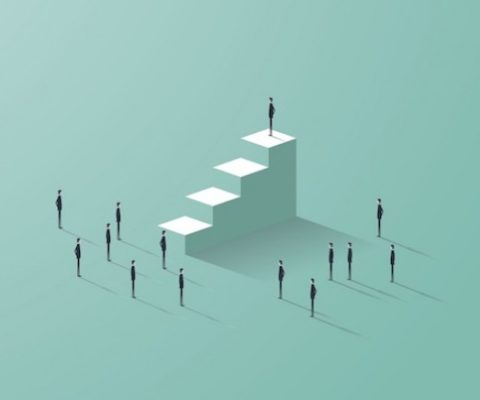

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)



![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)























![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)