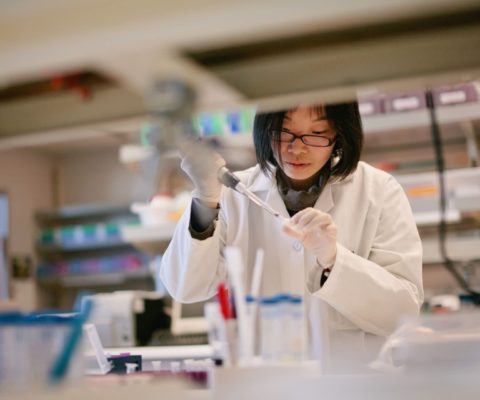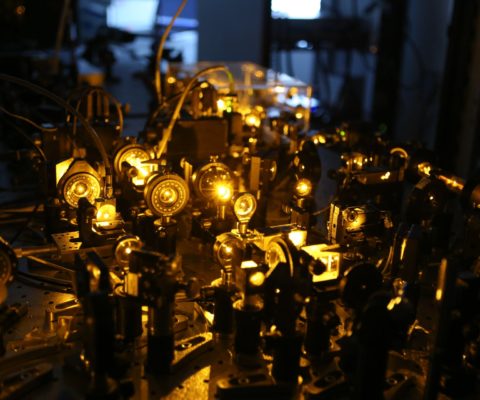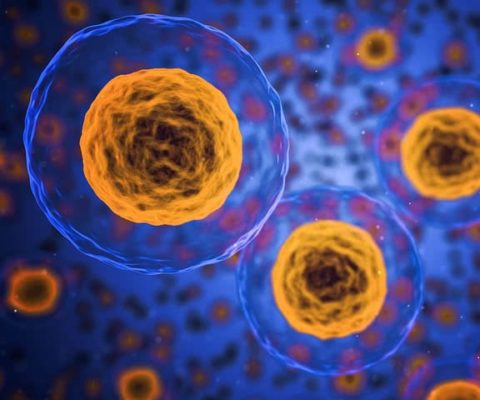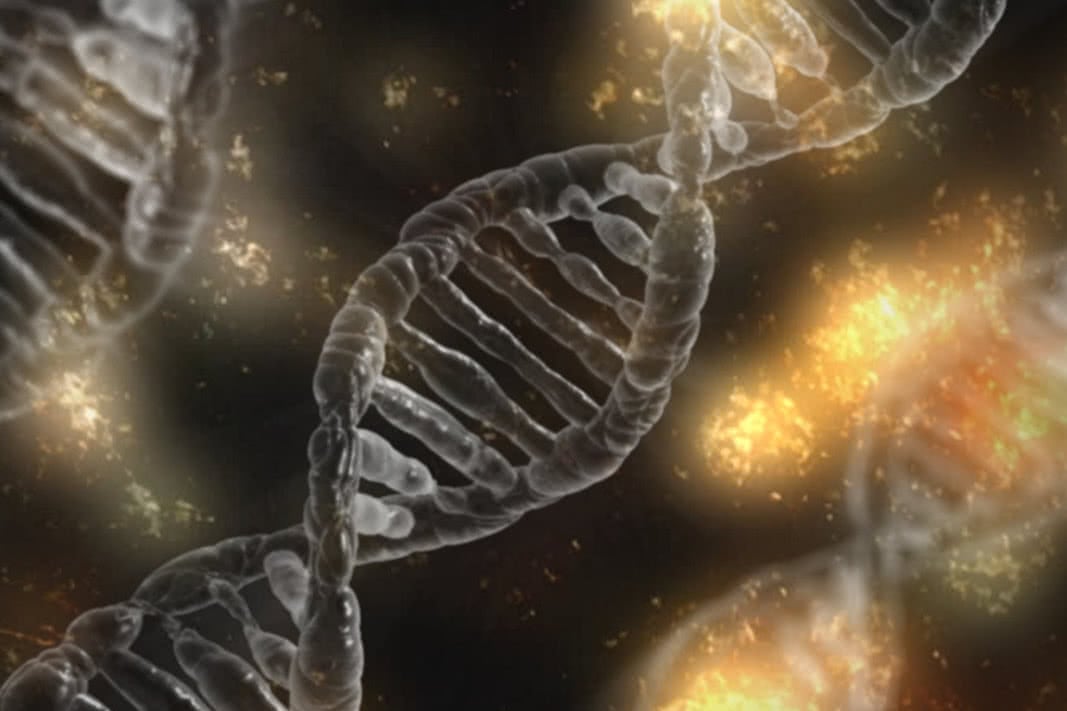
L’épigénétique s’est enfin imposée
Des modifications de l’expression des gènes qui ne changent en rien la séquence d’ADN, mais qui sont héritables d’une cellule à ses filles, voire de parent à enfant… tel est l’objet de l’épigénétique, discipline qui ne cesse de bouleverser la biologie depuis la fin des années 1980. L’éclairage d’Édith Heard, chaire Épigénétique et mémoire cellulaire.

Qu’est-ce que l’épigénétique ?
Le mot « épigénétique » est né à l’instigation du biologiste britannique Conrad Waddington. En 1942, il a tenté de réunir deux mondes de la biologie : d’un côté, après la redécouverte des lois de Mendel, en 1901, les généticiens exploraient la fonction des gènes chez la drosophile ; de l’autre, les embryologistes recherchaient comment, à partir d’un œuf fécondé, on arrivait à un organisme complexe. Waddington a émis l’hypothèse que le développement embryonnaire mobilisait des réseaux changeants d’interactions entre gènes. Et il a donné à l’étude des mécanismes en jeu le nom d’« épigénétique », fusion des termes « épigenèse » et « génétique ». L’épigenèse désignait l’idée d’Aristote selon laquelle un organisme vivant se développe à partir d’une cellule simple en se complexifiant peu à peu. Ses partisans venaient de remporter une longue bataille contre ceux de la préformation – l’idée que les spermatozoïdes ou les ovules contenaient déjà de petits êtres préformés.
Mais l’utilisation du terme « épigénétique » a stagné. À la fin des années 1950, à l’institut Pasteur, à Paris, François Jacob et Jacques Monod ont découvert chez les bactéries un mécanisme de régulation de l’expression des gènes par interaction d’une molécule avec une région spécifique de l’ADN, et les embryologistes se sont lancés sur cette voie. Christiane Nüsslein-Volhard et Eric Wieschaus, à l’EMBL, à Heidelberg, ont ainsi montré que chez la drosophile, des facteurs dits de transcription mettent en place le programme de développement, mais personne ne parlait d’épigénétique.
Comment a-t-on pris conscience de l’importance des phénomènes épigénétiques ?
Au cours du XXe siècle, on s’est aperçu qu’en culture, les cellules provenant de différents tissus se divisaient sans perdre leur identité. Comment gardaient-elles cette mémoire ? D’autant qu’en 1962, John Gurdon, à l’université d’Oxford, avait prouvé que le noyau d’une cellule somatique (c’est-à-dire non germinale) contient toute l’information génétique pour produire n’importe quelle cellule (il avait créé une grenouille en transplantant le noyau d’une cellule intestinale dans un ovocyte énucléé). C’était la preuve que chaque cellule de l’organisme contient le même génome. Comment, alors, était enregistrée l’identité d’une cellule si ce n’était pas dans le génome ?
Or à la même époque, des biologistes ont découvert une modification de l’ADN, nommée méthylation, qui ne touche pas sa séquence, mais ajoute une étiquette sur une de ses quatre bases. On détectait un certain profil de méthylation sur les gènes, qui ne changeait pas au fil des divisions cellulaires et était associé à une expression plus ou moins importante de ces gènes. Cette méthylation était-elle la mémoire recherchée ?
C’est ce qu’ont proposé l’Américain Art Riggs et le Britannique Robin Holliday en 1975, et tout a convergé dans les années 1980 grâce à divers résultats : des cellules traitées avec un inhibiteur de la méthylation perdaient parfois leur identité ; et la méthylation pouvait expliquer des phénomènes qui ne suivaient pas les règles classiques de la génétique, comme l’empreinte parentale (l’expression différentielle des gènes hérités du père et de la mère) et l’inactivation du chromosome X (les femelles en ont deux copies génétiquement identiques, mais une seule s’exprime). L’explication s’est révélée exacte par la suite.
En 1987, Holliday a introduit le terme « épimutation » pour décrire les changements héritables des gènes non dus à une modification de la séquence d’ADN et, en 1994, il a redéfini l’épigénétique comme l’étude des changements d’expression des gènes transmissibles au fil des divisions cellulaires, voire des générations, sans changement de la séquence d’ADN. Dès lors, l’épigénétique s’est enfin imposée.
Qu’a-t-elle apporté ?
On a compris que les marques épigénétiques (la méthylation et d’autres trouvées ensuite) jouent un rôle majeur dans la régulation de l’expression des gènes. Par exemple, beaucoup de gènes impliqués dans le cancer codent des facteurs qui modifient ces marques. Des mutations de ces facteurs peuvent changer tout l’épigénome d’une cellule et avoir un effet néfaste sur son identité et sa capacité à se diviser ou à interagir avec son environnement. Une autre grande découverte est liée à celle de Shinya Yamanaka, de l’université de Kyoto, qui lui valut le prix Nobel en 2012 avec John Gurdon. En 2006, il a montré que quatre facteurs de transcription suffisent pour reprogrammer une cellule somatique en cellule embryonnaire, mais le processus était très inefficace. Aujourd’hui, on sait qu’en modifiant les marques épigénétiques, on facilite la reprogrammation : on parle d’une barrière épigénétique protégeant l’identité cellulaire.
On se rend compte aussi que ces processus de mémoire cellulaire sont importants au cours du développement : on retrouve l’épigénétique de Waddington ! Enfin, il s’avère que les marques épigénétiques contrôlent une partie de ce que l’on nommait jusqu’à récemment l’ADN poubelle : des éléments transposables qui peuvent se déplacer dans le génome. Ces éléments attirent les marques et, quand on supprime celles-ci, ils bougent en modifiant l’expression des gènes… Serait-ce un mécanisme de régulation fine des gènes, voire d’évolution rapide en réponse à un stress ? Il s’agit à présent de trouver le lien entre hérédité, programme génétique, développement et épigénétique. Je suis convaincue que les éléments transposables y jouent un grand rôle.
Propos recueillis par Marie-Neige Cordonnier
Paru dans Pour la science, numéro spécial 481, novembre 2017
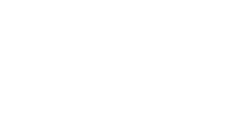
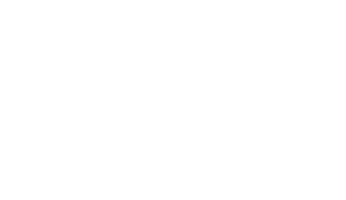




















![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)
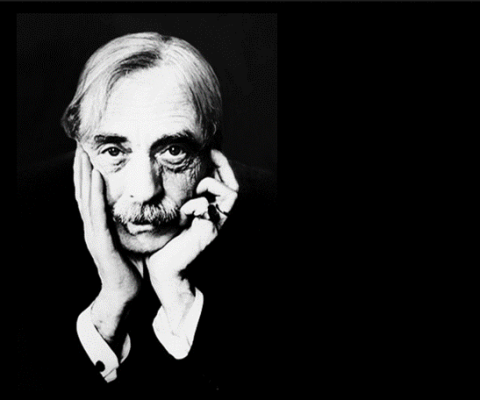


![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)



![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)






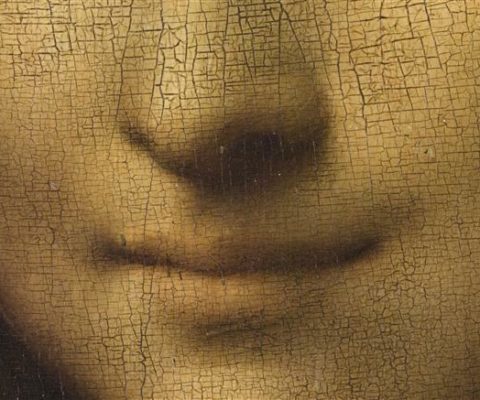

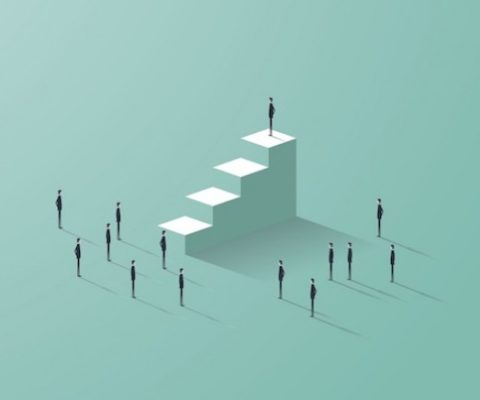
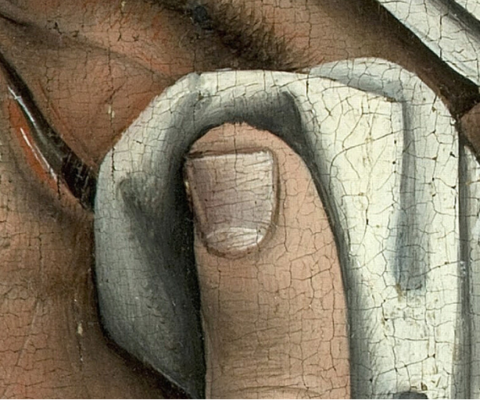
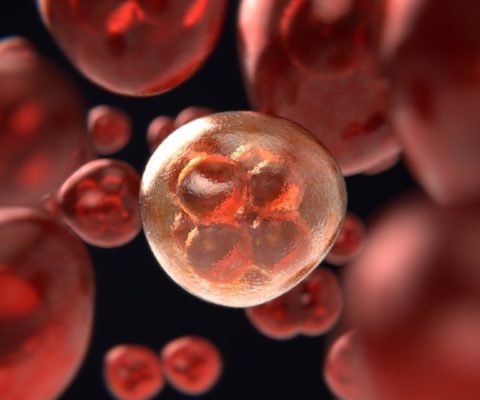

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)
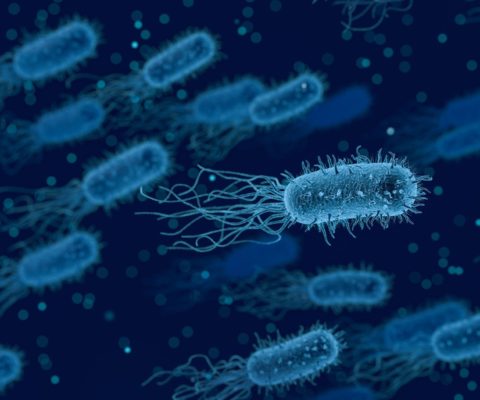



![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)



























![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)