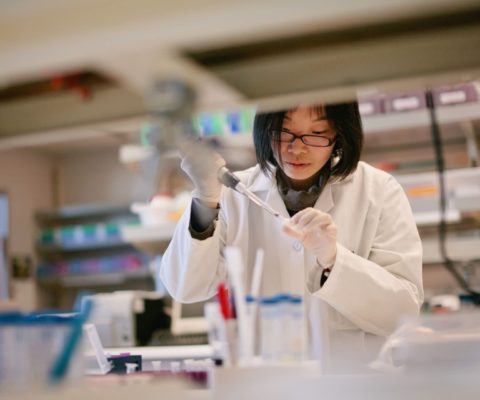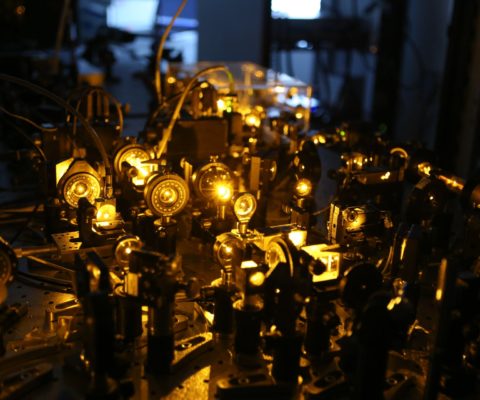Le travail au XXIe siècle : nouveaux risques et nouvelles opportunités
Pr Alain Supiot
 Notre notion moderne de travail est née avec l’avènement du capitalisme. La grande diversité de ce qu’on appelait auparavant les arts mécaniques et libéraux, a été ramenée par lui à une même catégorie abstraite de « travail », échangeable sur un « marché du travail ». Cette assimilation du travail à une marchandise est un trait propre du capitalisme, qui procède de même avec la Terre et la monnaie. Mais il s’agit de ce que Karl Polanyi a nommé des ‘marchandises fictives’. On fait ‘comme si’ c’étaient des produits, alors qu’il s’agit de conditions préalables à la production et l’échange. Le capitalisme repose ainsi sur des fictions juridiques, dont celle du travail, envisagé comme une chose détachable du travailleur qui le fournit. Or les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques. Ce sont des procédés techniques dont l’efficacité sur le long terme suppose de tenir compte du principe de réalité. Le travail, la Terre et la monnaie ne peuvent ainsi être durablement assimilés à des marchandises, que moyennant le respect de conditions juridiques, qui enracinent le temps court des échanges marchands dans le temps long de l’entretien et de la reproduction de la vie humaine, des ressources naturelles, ou de la foi (du crédit) dans la valeur de la monnaie. Telle a été, s’agissant du travail, la fonction de l’État social, qui n’a pas remis en cause la fiction du travail-marchandise, mais l’a rendue humainement vivable en insérant dans le contrat de travail un statut assurant la sécurité physique et économique des travailleurs. Sans cette grande invention juridique, les démocraties n’auraient pu l’emporter sur les régimes totalitaires du XXème siècle, car « ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures » (F.D. Roosevelt).
Notre notion moderne de travail est née avec l’avènement du capitalisme. La grande diversité de ce qu’on appelait auparavant les arts mécaniques et libéraux, a été ramenée par lui à une même catégorie abstraite de « travail », échangeable sur un « marché du travail ». Cette assimilation du travail à une marchandise est un trait propre du capitalisme, qui procède de même avec la Terre et la monnaie. Mais il s’agit de ce que Karl Polanyi a nommé des ‘marchandises fictives’. On fait ‘comme si’ c’étaient des produits, alors qu’il s’agit de conditions préalables à la production et l’échange. Le capitalisme repose ainsi sur des fictions juridiques, dont celle du travail, envisagé comme une chose détachable du travailleur qui le fournit. Or les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques. Ce sont des procédés techniques dont l’efficacité sur le long terme suppose de tenir compte du principe de réalité. Le travail, la Terre et la monnaie ne peuvent ainsi être durablement assimilés à des marchandises, que moyennant le respect de conditions juridiques, qui enracinent le temps court des échanges marchands dans le temps long de l’entretien et de la reproduction de la vie humaine, des ressources naturelles, ou de la foi (du crédit) dans la valeur de la monnaie. Telle a été, s’agissant du travail, la fonction de l’État social, qui n’a pas remis en cause la fiction du travail-marchandise, mais l’a rendue humainement vivable en insérant dans le contrat de travail un statut assurant la sécurité physique et économique des travailleurs. Sans cette grande invention juridique, les démocraties n’auraient pu l’emporter sur les régimes totalitaires du XXème siècle, car « ceux qui ont faim et sont au chômage sont la substance dont sont faites les dictatures » (F.D. Roosevelt).
Depuis une quarantaine d’années, trois facteurs ont profondément ébranlé cette construction institutionnelle. Tout d’abord les politiques néolibérales qui, effaçant les frontières financières et commerciales, ont engagé les États dans une course au moins-disant social et environnemental. Ensuite la révolution numérique qui, pour le meilleur et pour le pire, transforme profondément nos façons individuelles et collectives de travailler. Et enfin, last but not least, le dépassement, chaque année plus considérable depuis 1971, des capacités de régénération des ressources naturelles, qui rend à l’évidence insoutenable la globalisation économique et financière. Cette déstabilisation de l’Etat social engendre presque mécaniquement le retour à une situation ainsi décrite par le Préambule de la Constitution de l’OIT (Organisation internationale du travail) : « il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger ». D’où la floraison ces dernières années de gouvernements qui, pour répondre à ce mécontentement sans avoir à poser à nouveaux frais la question de la justice sociale et écologique, désignent des boucs émissaires et attisent les identités nationales, ethniques ou religieuses.
Le problème de notre temps n’est cependant pas de choisir entre la globalisation et des repliements identitaires aveugles à l’interdépendance des peuples face aux périls écologiques et sociaux. Le problème est de bâtir un ordre juridique mondial respectueux de notre écoumène (NDLR : inscription des activités humaines dans leurs milieux vitaux), du travail humain et de la diversité des peuples et des cultures. Pour en comprendre les termes, on peut user de la distinction que la langue française autorise entre globalisation et mondialisation. Globaliser, c’est œuvrer au règne uniforme et sans partage de « l’ordre spontané du Marché ». Mondialiser, au sens premier de ce mot (où « monde » s’oppose à « immonde », comme « cosmos » s’oppose à « chaos »), consiste à rendre humainement vivable un univers physique : à faire de notre planète un lieu habitable. Ce qui requiert des institutions propres à soumettre les forces du marché à des règles et à articuler les solidarités nationales aux solidarités locales ou internationales. Les institutions dont nous avons hérité du XXème siècle doivent, à tous ces niveaux, être repensées dans cette perspective.
C’est le cas notamment de l’OIT, dont on va célébrer le centenaire cette année. Sa constitution s’ouvre sur l’affirmation selon laquelle « une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ». Il n’est pas besoin d’évoquer « les gilets jaunes » pour comprendre que la leçon ainsi tirée des massacres de la Première guerre, leçon répétée par la Déclaration de Philadelphie au sortir des massacres de la Seconde, n’a rien perdu de son actualité, de même que demeure actuel le mandat constitutionnel qui a été donné à l’OIT d’empêcher que « la non-adoption par une nation quelconque d’un régime de travail réellement humain (ne fasse) obstacle aux efforts des autres nations désireuses d’améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ».
Les conditions dans lesquelles l’OIT doit remplir cette mission ont en revanche profondément changé. De nos jours, les États ne sont plus les seuls acteurs sur la scène internationale. Les grandes entreprises multinationales y jouent un rôle important, que le Droit peine à prendre en compte. Par un étrange renversement, on accorde aujourd’hui à certaines d’entre elles (too big to fail) une intangibilité et des responsabilités sociales et environnementales qui étaient jadis l’apanage des États, tandis qu’on exige en revanche de ces derniers qu’ils se conduisent comme des entreprises. D’autre part, l’OIT n’est plus que l’une des 15 institutions spécialisées du système des Nations Unies, et ses missions — comme du reste celles de l’OMS — l’Unesco ou la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), se trouvent contredites sur de nombreux points par celles confiées à l’OMC, le FMI ou la Banque Mondiale. Enfin, la révolution informatique s’accompagne d’un imaginaire normatif, selon lequel le règne du Droit (rule of law) devrait céder la place à la gouvernance par les nombres. Cette gouvernance, dont la planification soviétique ne fut que l’avant-courrier, est à l’œuvre dans toutes les institutions (y compris universitaires). Fruit du fantasme de la programmation des êtres humains, elle engendre de nouvelles formes de déshumanisation du travail, et de nouveaux risques, notamment pour la santé mentale. Elle étend aux humains le mode de fonctionnement de nos nouvelles machines au lieu de les mettre au service de leur émancipation. Ayant vocation à prendre en charge toutes les tâches programmables, ces nouveaux instruments nous donnent au contraire la possibilité historique d’édifier un « régime de travail réellement humain » qui, conformément aux vœux de la Déclaration de Philadelphie, donne à tous les êtres humains la possibilité d’éprouver dans leur travail « la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ».
Pr Alain Supiot
Chaire État social et mondialisation : analyse des solidarités
Membre de la commission mondiale sur l’avenir du travail
Pour aller plus loin :
- Colloque : Le travail au XXIe siècle : Droit, techniques, écoumène (colloque du Collège de France, 26 et 27 février 2019)
- La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014) (Fayard, 2015)
- La solidarité. Enquête sur un principe juridique (O. Jacob, 2015)
- Qu’est-ce qu’un régime de travail réellement humain ? (Hermann, 2018)
- Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil (Editions du Collège de France, mars 2019)
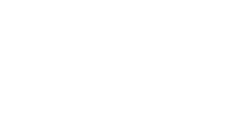
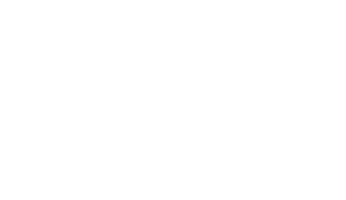









![[VIDÉO] Comment s’arrêtent les pandémies ?](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2022/04/masque-rue-480x400.jpeg)
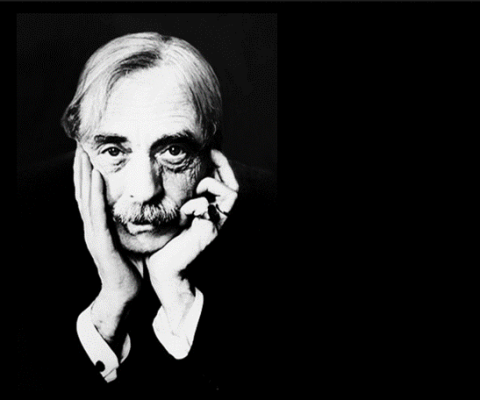


![[VIDÉO] Agir pour l’éducation](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/12/Capture-décran-2021-12-02-à-18.28.29-480x400.png)



![[VIDÉO] Un monument de la pensée : le cours de Poétique de Valéry](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2021/10/4K1B8515-480x400.jpg)




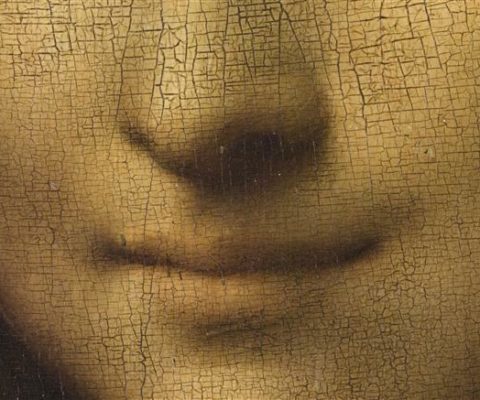

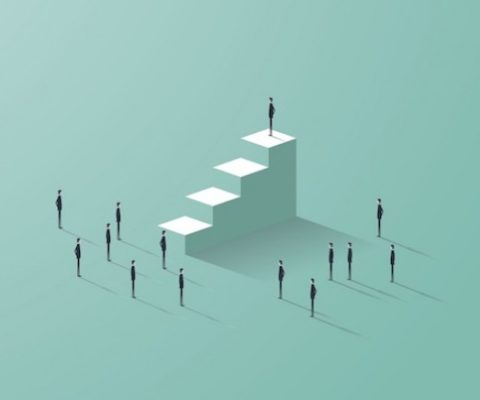

![[VIDÉO] Regards croisés sur le défi climatique](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/12/Image-Article-site-FCDF-480x400.png)



![[PUBLICATION] Une Boussole pour l’Après](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2020/08/Couverture-Boussole-pour-Après-480x400.png)
























![[VIDÉO] Réflexions sur la vérité scientifique dans une époque trouble](https://www.fondation-cdf.fr/wp-content/uploads/2019/10/S.Haroche-conf-480x400.jpg)